-
Publié le par Florian Rouanet
Eh oui Jean-Tradi', il y a vraie et fausse réforme!
Défendons donc la « messe de toujours », mais en connaissance de cause !
⁂ 𝔄rène du rite
ℭher lecteur, souffrez que nous fassions, derechef, l’inventaire de mauvais arguments lesquels encombrent la défense de la liturgie dite de saint Pie V. Point de procès d’intention : nous aimons ce Missel, nous l’observons, nous le servons, nous l’avons élu domicile dans nos chapelles de Tradition, mais, à Dieu ne plaise, nous ne le défendrons pas avec des armes de pacotille.
À rebours de billevesées légalistes, le cœur de l’affaire est doctrinal : si la réforme de Montini alias Paul VI a mutilé l’expression catholique du saint Sacrifice, alors l’attachement au rite romain traditionnel n’est point caprice d’esthète, situé en dehors du temps, des bulles, mais bien un devoir de conscience.
Tandis que le blaireau de sacristie, l’œil fier et la manchette amidonnée, brandit Quo primum tempore comme un gri-gri africain, et s’en va décréter que nul Pape, jamais, ne saurait toucher au Missel romain… Qu’on se détrompe : pareille affliction procède d’un fatras de mots — vulgarisés, imprécis — pris à la lettre et d’un mépris des distinctions. Les clauses dites de « perpétuité » sont style juridique, non dogme immuable précisément ici ; le droit liturgique est mutable en sa partie humaine ; c’est la substance des sacrements qui, elle, est intangible.
🏟 bandez les muscles, aiguisez votre plume : quand bien même l’on maugréerait des « indults », l’ordre surnaturel s’écrit en logos : la liturgie relève du droit humain, sauf au seuil du droit divin. C’est pourquoi, si l’on refuse la « réforme », ce n’est pas parce qu’elle est nouvelle, mais parce que, fausse et nocive, elle affaiblit — voire supprime — la foi, la grâce et la doctrine sur l’Hostie immolée.
Voilà notre mantra de guerre : non nova, sed mala.📄 Avertissement — Le document de travail du jour (ici résumé) est mentionné au titre de grande matière première pour la présente.
Ainsi, attention à ne pas faire dire à ces mots ce qu’ils ne disent pas : GoogleDocs !
🎭 Renouons avec l’évidence : ce n’est point la vétusté qui sanctifie, mais la vérité — et c’est bien là que le Missel de 1969 chancelle !

🎙️ Antenna I.O. Vox Frequencia — capsules audios pour se retremper :
☧ 𝔏exique de cogneur
LITURGIE — « Forme publique et officielle du culte, ordonnée par l’autorité ecclésiastique. ».
DROIT HUMAIN (positif) — « Dispositions canoniques instituées par l’Église et sujettes à évolution. »
DROIT DIVIN — « Ce qui procède de l’institution du Christ ou de l’Écriture, intangible par autorité humaine. »
NOCIVITÉ — « Caractère d’un acte ou d’une loi qui nuit au bien visé par la loi supérieure (foi, culte, salut). »
ARCHÉOLOGISME — « Tendance à vouloir restaurer l’ancien parce que ancien, sans égard au discernement doctrinal. »🪢 Cordage terminologique (inspiré du CNRTL) — on évite l’incompréhension des « droits acquis » : coutume ≠ droit divin ; perpétuité de style ≠ dogme ; nouveauté ≠ corruption.
ᛟ 𝔄ncienne école éprouvée
Les assises canoniques, liturgiques et doctrinales sont du meilleur aloi !
« La sainte liturgie est donc le culte public que notre Rédempteur rend au Père comme Chef de l’Église ; c’est aussi le culte rendu par la société des fidèles à son Chef et, par lui, au Père éternel : c’est, en un mot, le culte intégral du Corps mystique de Jésus-Christ, c’est-à-dire du Chef et de ses membres. »
« Toute la liturgie donc contient la foi catholique, en tant qu’elle atteste publiquement la foi de l’Église. […] De là vient l’axiome connu et respectable : Legem credendi lex statuat supplicandi (“que la règle de la prière fixe la règle de la croyance”). »
« Revenir par l’esprit et le cœur aux sources de la liturgie sacrée est chose certes sage et louable […]; mais il n’est pas sage ni louable de tout ramener en toute manière à l’antiquité. […] Archéologisme excessif. […] Qui voudrait revenir aux antiques rites et coutumes, en rejetant les normes introduites sous l’action de la Providence, […] celui-là évidemment ne serait point mû par une sollicitude sage et juste. »
— Pie XII, Mediator Dei, §23/§46–48/§62–64 (rubrique « Archéologisme excessif »), le 20 novembre 1947, édition française https://laportelatine.org/formation/magistere/lettre-encyclique-mediator-dei-du-20-novembre-1947-pie-xii
« Il y a […] double motif à ce que la loi humaine soit modifiée à juste titre : du côté de la raison […] et du côté des hommes […] dont la condition change ; […] la loi humaine est donc modifiable ; […] la loi temporelle, bien qu’elle soit juste, peut être modifiée selon la justice au cours des temps (Saint Augustin). »
— S. Thomas d’Aquin, Somme théologique, Ia-IIae, q. 97, a. 1, concl. (trad. fr.)
« Si quelqu’un dit que, dans la messe, on n’offre pas à Dieu un véritable et propre sacrifice […] : qu’il soit anathème. »
— Concile de Trente, sess. XXII (17 septembre 1562), can. 1 (lien éd. anglaise fiable)
« Par in parem non habet imperium »
(« L’égal n’a pas autorité sur son égal »).
— Innocent III, maxime prononcée dans la décrétale Innotuit (De electione, X 1.6.20) — insérée dans le Liber extra de Grégoire IX. La démonstration classique se lit chez Stephan Kuttner, qui renvoie précisément à Innotuit : S. Kuttner, « The Bigamous Archbishop of Palermo », [MGH] Bibliothek, p. 17 : « Non habet imperium par in parem, the pope wrote in the decretal Innotuit (3 Comp. i.6.5 = X 1.6.20). »
« C’est donc un devoir strict pour tout prêtre voulant demeurer catholique de se séparer de cette Église conciliaire, tant qu’elle ne retrouvera pas la tradition du Magistère de l’Église et de la foi catholique. »
— Mgr Lefebvre, Itinéraire spirituel, 1990, p. 29).
Σ Plan d’attaque par manche
- 📌 I. Principe — Autorité, droit humain, droit divin.
- 🧭 II. Nouveauté ≠ nocivité — Le vrai critère : conformité doctrinale.
- 📜 III. Les faux appuis légalistes — Quo primum, indult, coutume, canon 30.
- 🧪 IV. Les cas d’école — Bréviaire, Jésuites, corrida, Ad hoc nos Deus.
- 🛡 V. Infaillibilité et lois universelles — Objet secondaire, faits dogmatiques.
- ⚖️ VI. Conséquences pratiques — Se gendarmer : tenue, prudence, rupture d’avec l’erreur.
🧰 Objections & ripostes !
📌 I. Principe : l’autorité règle le culte, sauf le droit divin
La liturgie, œuvre de l’Église, relève du droit humain ; elle applique la loi divine aux circonstances. De ce chef, le Pape (véritable, légitime…!), juge suprême de l’opportunité, dispose d’un pouvoir plénier pour modifier, abroger, réformer — sauf ce qui touche la substance des sacrements et la constitution divine de l’Église. Les Pontifes d’antan et contemporains — or, du scélérat Vatican II… — Léon XII et Léon XIII le rappellent, Pie XII le développe, saint Pie X exige l’obéissance probe, non la casuistique du hâbleur désœuvré.
Corollaire : si l’on rejette une réforme, ce ne sera jamais parce qu’elle est nouvelle, mais parce qu’elle est nocive (alors précisément, mieux vaut le statu quo ante).
🧭 II. Nouveauté ≠ nocivité : le critère est doctrinal
Il sied de distinguer :
- Nouveauté (novum) — accident des temps.
- Nocivité (noxium) — atteinte au sens du Sacrifice, au priesthood, à la présence réelle.
L’histoire corrobore cette distinction : de fait, l’Église a maints fois innové sans corrompre (psautier de saint Pie X, révision légère des rubriques par Pie XII) ; inversement, une innovation peut délabrer le symbole lorsque l’orientation subvertit. Telle est la plainte contre la nouvelle messe : appauvrissement ou ruine du lex orandi sur l’immolation propitiatoire, la notion de sacerdoce sacrificiel, la séparation du prêtre et des fidèles, etc. Voilà le nœud !
📜 III. Les faux appuis légalistes : Quo primum, indults, coutumes, canon 30
- Perpétuité de Quo primum (1570) : formule de style (« à perpétuité », « nulli ergo »), commune aux bulles de l’époque ; elle n’enchaîne pas les successeurs en matière de droit humain. La preuve ? Le Bréviaire de saint Pie V, lui aussi « à perpétuité », sera retouché par Clément VIII, Urbain VIII, saint Pie X, Pie XII.
- Indults & droits acquis : la liturgie n’est pas une propriété privée mais un bien public de l’Église ; un indult tolère, il ne canonise pas per se.
- Coutume immémoriale et canon 30 (CIC 1917) : nul doute, une loi ne révoque point une coutume centenaire sans mention expresse ; mais lorsqu’une loi liturgique universelle abroge en termes clairs, la coutume cesse — à moins que la loi soit contraire au droit divin (ce qui change tout, mais doit être constaté, prouvé, dénoncé).
- Défaut de forme dans la promulgation : chimère. Le législateur suprême n’est pas lié par les procédures prévues pour les législateurs inférieurs ; ce qui compte, c’est l’intention claire et l’acte du Pape, ou présumé tel.
Conclusion de manche : ne vous arc-boutez pas sur des échappatoires, attaquez le cœur : la doctrine d’ordre divin !
🧪 IV. Cas d’école : histoire, maîtresse de véracité
- Bréviaire de Quignonez : approuvé par plusieurs Papes, puis abrogé sans retour par saint Pie V.
- Saint Pie V lui-même : Ad hoc nos Deus (1570), adaptations pour l’Espagne et les Indes : oraisons, mentions, même canon orné de prières pour le roi — sic.
- Exemples avec les Jésuites : Jules III approuve « à perpétuité » (1550) ; Clément XIV supprime « à perpétuité » (1773) ; Pie VII rétablit (1814). Cela implique seulement autorité papale auprès des fidèles et solennité.
- Corrida : saint Pie V (1567) frappe d’excommunication ; Grégoire XIII (1572) et Clément VIII (1596) relâchent pour l’Espagne.
Effet probant : aucune formule de perpétuité en matière pure disciplinaire ne survit ipso facto à la volonté contraire d’un Pape — sauf évidente collision avec le droit divin.
🛡 V. Infaillibilité & lois universelles : lex orandi, lex credendi
Selon l’Aquinate, Lépicier, Mgr Gasser (Concile du Vatican), l’infaillibilité ne couvre pas seulement l’objet primaire (vérités révélées), mais aussi l’objet secondaire : vérités connexes, faits dogmatiques, lois disciplinaires universelles, notamment liturgiques, dans la mesure où elles sont nécessaires à la garde du dépôt.
Conséquence austère : affirmer qu’une loi liturgique universelle, en tant que telle, égare l’Église revient à poser que l’Église trempe ses fils dans l’erreur — hypothèse impossible.
Distinction salutaire : autre chose est une loi viciée dans son expression (susceptible d’induire des interprétations contraires à la foi), autre chose est l’infaillibilité des décrets qui proposent la foi. C’est ici que se loge la critique grave du pseudo Novus Ordo : non parce qu’il est novum, mais parce qu’il sape, par omissions ou accentuations, la doctrine sacrificielle reçue. Là se trouve l’acte de légitime défense !
⚖️ VI. Conséquences pratiques : fermeté sans cabotinage
-
Tenue : honorer l’autorité, refuser l’erreur. Nulle chienlit ni invectives, mais une projection logique : là où la « néo-église conciliaire-synodale« , en corps, propage des catégories incompatibles avec la Tradition (œcuménisme relativiste, anthropocentrisme du culte), il échoit de tenir le cap — rupture avec l’erreur — et avec ceux qui la propage ! —, filiation avec la foi catholique.
-
Vrai pastoral : fuir le centre aéré-arriéré trans-LGBT et autres compromis mous ; servir la messe dites de toujours par la doctrine de toujours ; et cesser de se répandre en imprécations sur les « indults »…
-
Juridique : employer le droit comme bouclier, non en idole. Le droit suit la doctrine, du reste, comme l’ombre suit le corps.
☩ 𝔖entence par KO
➖ Ligne directrice ! Le Missel de saint Pie V ne se défend pas par un talisman de chancellerie, mais par l’étincelle vérité : la réforme de 1969 pervertit l’axe du Sacrifice, alors nous cessons de céder, nous tenons, et nous chantons la messe de toujours non parce qu’elle est d’autrefois, mais parce qu’elle dit la foi.
Défendre la liturgie traditionnelle par la doctrine oui, non par les échappatoires légalistes ; séparer nettement droit divin et droit humain ; prouver la nocivité intrinsèque de la réforme de 1969 ; agir en catholiques instruits, et à cet effet savoir que :
- L’usage du Missel de saint Pie V ne doit pas être défendu par des arguments juridiques (indult, Quo primum, droits acquis, immémorialité, etc.) mais par une raison : la nocivité intrinsèque de la nouvelle messe de Paul VI. L’autorité de l’Église (par son Pape légitime) aurait le droit, en soi, de modifier la liturgie, tant que cette réforme reste conforme à la Tradition. Il y a condamnation en outre de l’archéologisme : vouloir revenir à l’ancien uniquement parce qu’il est ancien est jugé malsain et condamné (Pie XII, Mediator Dei ; Pie VI, Auctorem fidei). En effet, car s’opposer à ce principe engendre une perte de respect pour l’autorité et ouvre la voie aux divisions entre catholiques. De plus, l’histoire de l’Église montre qu’elle a souvent modifié ou supprimé des pratiques légitimes, saintes et anciennes, preuve qu’aucune prescription liturgique de droit purement humain n’est intangible. De même, les soi-disant autorités affirmant le contraire (Ratzinger, Medina, Benoît XVI en 2007) s’opposent aux faits historiques et aux principes du droit canon.
Gong final : appelez l’ambulance pour les sophismes, car ils gisent au tapis. La foi demeure ; la liturgie est son verbe.
« Cependant de ces constatations devons-nous conclure qu’il fallait garder toutes ces choses sans changement [référence aux changements intervenus à l’époque entre le missel de 1962 et celui de 1965] ? Le Concile avec mesure et prudence a répondu par la négative. Quelque chose était à réformer et à retrouver.
Il est clair que la première partie de la messe faite pour enseigner les fidèles et leur faire exprimer leur foi avait besoin d’atteindre ces fins d’une manière plus nette et dans une certaine mesure plus intelligible. À mon humble avis deux réformes dans ce sens semblaient utiles : premièrement les rites de cette première partie et quelques traductions en langue vernaculaire.
Faire en sorte que le prêtre s’approche des fidèles, communique avec eux, prie et chante avec eux, se tienne donc à l’ambon, dise en leur langue la prière de l’oraison, les lectures de l’Épître et de l’Évangile ; que le prêtre chante dans les divines mélodies traditionnelles le Kyrie, le Gloria et le Credo avec les fidèles. Autant d’heureuses réformes qui font retrouver à cette partie de la messe son véritable but. Que l’ordonnance de cette partie enseignante se fasse d’abord en fonction des messes chantées du dimanche, de telle manière que cette messe soit le modèle suivant lequel les rites des autres messes seront adaptés, autant d’aspects de renouvellement qui apparaissent excellents. Ajoutons surtout les directives nécessaires à une prédication vraie simple, émouvante, forte dans sa foi et déterminante dans les résolutions. C’est là un des points les plus importants à obtenir dans le renouveau liturgique de cette partie de la messe.
Pour les sacrements et les sacramentaux, l’usage de la langue des fidèles semble encore plus nécessaire, puisqu’ils les concernent plus directement et plus personnellement. »— Mgr Marcel Lefebvre, article « Perspectives conciliaires entre la troisième et la quatrième session » dans Itinéraires, n°95 de juillet-août 1965)
📚 Pour approfondir
Antiquité et premiers siècles chrétiens
- Saint Irénée, Saint Polycarpe, Saint Basile, Saint Ambroise, Saint Jean Chrysostome, Saint Jérôme : Pères de l’Église, témoins des usages primitifs de la liturgie.
- Concile de Nicée (325), puis Laodicée (IVᵉ s.), Trullo (692), Constance (1414-1418), Cashel (1172) : décisions conciliaires concernant discipline et liturgie.
- Saint Léon le Grand, Lettre 147 à Rusticum (vers 450).
- Saint Gélase Ier, Lettre IX aux évêques de Lucanie (494).
- Saint Augustin, Lettre 185 à Boniface (vers 417).
- Innocent III, Décrétales (début XIIIᵉ siècle) — principe juridique : « l’égal n’a pas autorité sur son égal ».
Moyen Âge
-
Clément VI, Lettre Super quibusdam (1351), sur l’autorité pontificale.
XVIᵉ siècle (Réforme liturgique tridentine)
-
Concile de Trente, Session XXI (1562), décret sur la communion sous une seule espèce.
-
Saint Pie V :
-
Bulle De salute gregis (1567) — contre les corridas.
-
Bulle Quod a nobis (1568) — réforme du Bréviaire romain.
-
Bulle Quo primum tempore (1570) — promulgation du Missel romain.
-
Bref Ad hoc nos Deus (1570) — adaptation du Missel pour l’Espagne.
-
-
Grégoire XIII, Bref Pastoralis officii cura (1573) — modification limitée du Bréviaire.
-
Clément VIII :
-
Cum in Ecclesia (1602) — sur l’office divin.
-
Cum sanctissimum (1604) — sur l’usage liturgique.
-
-
Urbain VIII :
-
Divinam psalmodiam (1631) — réforme des hymnes du Bréviaire.
-
Si quid est (1634) — ajustement des rubriques.
-
XVIIIᵉ siècle
- Benoît XIV, Encyclique Magnæ Nobis (1748).
- Clément XIV, Bref Dominus ac Redemptor (1773) — suppression de la Compagnie de Jésus.
- Pie VI, Constitution Auctorem fidei (1794) — condamnation du synode de Pistoie.
XIXᵉ siècle
- Pie VII, Bulle Sollicitudo omnium Ecclesiarum (1814) — rétablissement de la Compagnie de Jésus.
- Léon XII, Exhortation Pastoris Aeterni (1826).
- Dom Prosper Guéranger, Institutions liturgiques (1830-1840) — défense du rite romain.
- Léon XIII :
-
Epistola tua (1885).
-
Testem benevolentiae (1899).
-
XXᵉ siècle (réformes et débats liturgiques)
-
Saint Pie X, Constitution Divino afflatu (1911) — réforme du Psautier.
-
Benoît XV, Décret de canonisation (1920).
-
Pie XII :
-
Sacramentum ordinis (1947) — sur la matière et la forme du sacrement de l’ordre.
-
Encyclique Mediator Dei (1947) — grande charte de la liturgie.
-
Décret Cum hac nostra aetate (1955) — simplification des rubriques.
-
Décret Maxima redemptionis mysteria (1955) — réforme de la Semaine Sainte.
-
Lettre Ad Apostolorum Principis (1958).
-
-
Mgr Joseph Clifford Fenton, article (1962) — théologien américain, défense du magistère.
-
Jean XXIII :
-
Code des Rubriques (1960).
-
Réforme du Missel romain (1962).
-
-
Cardinaux Ottaviani et Bacci, Bref examen critique du Novus Ordo Missae (1969).
Après-Concile et critiques contemporaines
-
Mgr Marcel Lefebvre :
-
Article dans Itinéraires (1965).
-
Itinéraire spirituel (1990).
-
-
Canonistes :
-
Chanoine Naz, Traité de droit canonique.
-
Cappello SJ.
-
Claeys Bouuaert, Dictionnaire de droit canonique.
-
- Abbé Jean-Michel Gleize, articles dans Courrier de Rome.
- Abbé Daniele di Sorco, articles dans Courrier de Rome (2021).
- Apologètes conciliaires : James Likoudis et Ken Whitehead, The Pope, the Council, and the Mass.
💸 Soutenir l’œuvre : https://fr.tipeee.com/florian-rouanet
💬 Rejoindre la communauté : https://t.me/francenatio— La Rédaction
🥊 𝔑𝔬𝔰 𝔞𝔯𝔱𝔦𝔠𝔩𝔢𝔰 𝔡𝔢 𝔩𝔞 𝔖𝔱𝔯𝔞ß𝔢
Tableaux des doctrines & scénarios de l’actuel catholicisme de Tradition (avec Griff Ruby)
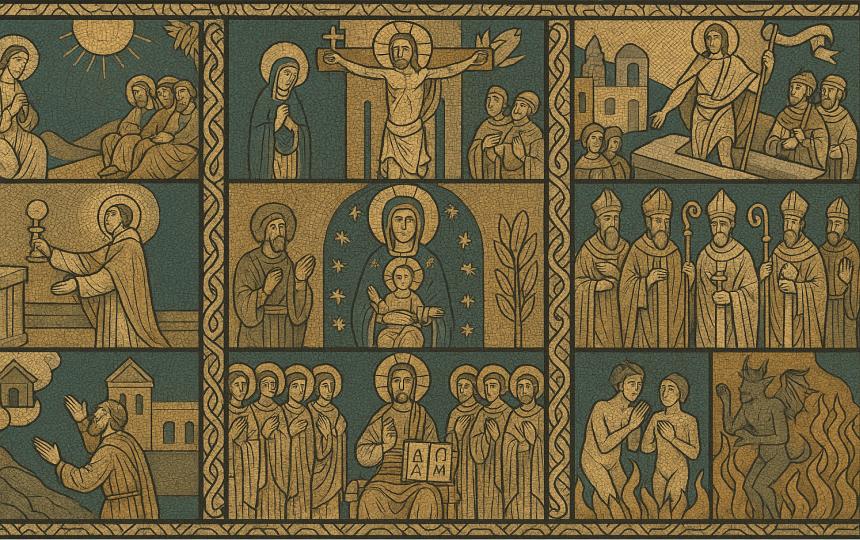
Double reprise en main sur notre toile technique et rythme de publications

Pour en finir avec le Lesquenisme — Pierre Joly

Noms premiers d’Europe et d’Occident : l’auguste origine des patries de l’ouest

Méditer pour un christianisme positif, unitaire et politique, sans sophisme ni hérésie : est-ce possible ?

Défense de l’Occident ou l’Orient tentateur ? Henri Massis, ego non

Abel Bonnard : contre conservateur mou et radicalisme de gauche chimérique, ego non

Par essence, la franc-maçonnerie nourrit une aversion du fascisme comme du catholicisme

Formons-nous et vivons en tant que reflet de ce que nous souhaitons collectivement, puis diffusons cette bonne parole vertueuse, catholique et française-européenne

Le subconscient et les cinq clés tirées de la psychologie jungienne

De la nature à la grâce, de la race à la foi : nationalisme, impérialisme germanique et christianisme, bal des « ismes »

Prier, agir et bâtir : du cénacle aux pavés, contre l’inertie avec discernement historique (Terre, Peuple, Chrétienté du MNC)

Royaume visible et invisible : des frontières de chair et d’âme, de sang et de grâce

Le conclavisme, ou l’ombre portée du cardinal Bonaparte et de Mgr Maret au XIXème siècle

Catholiques romains : contre l’arianisme au IVème siècle, puis contre le catholicisme libéral de Vatican II

Dom Prosper Guéranger et le sens chrétien de l’histoire : naturel et surnaturel contre la confiscation marxiste de l’expression

Temps apostolique des apôtres et Tradition : le rôle épiscopal mis en parallèle d’hier à nos jours dans la tempête antimoderniste

Contre les Pie VI et VII : de Pistoie à ladite Petite Église, deux viles résistances historiques à l’unité pontificale

Du pontife à la Sede Apostolica : étude sur la papauté physique divine et le Saint-Siège moral-juridique

Qu’est-ce que la grâce divine et sa gratuité, clef de la vie chrétienne ?

La Jérusalem infidèle fut visible, oui, mais en sa trahison : comparaison avec la Rome conciliabulaire moderniste

La juridiction de l’Église sur la cité : foi, mœurs et pouvoir

Les mauvais motifs d’être attaché à la liturgie de saint Pie V
Liturgie, droit humain mutable, nocivité du Novus Ordo, autorité papale exclusive, faux droits acquis, archéologisme — Un document signé philosophieduchristianisme.wordpress.com !
Vous avez aimé cet article ? Partagez-le sur les réseaux sociaux !
[Sassy_Social_Share]
Merci de votre visite sur notre site !
Ce site internet est la propriété de M. Florian Rouanet.
Vous pouvez reproduire nos articles à condition de mentionner le lien d'origine.


2 commentaires
Réagissez à cet article !